|
 Sommaire du JDJ n° 433
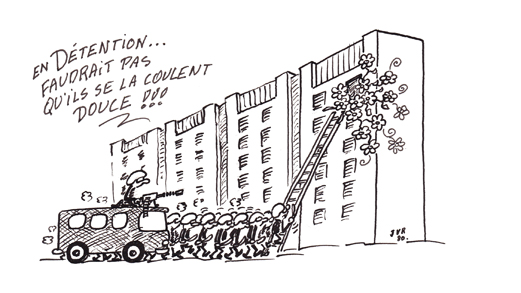 Articles
Documents
Fiche JDJ
Jurisprudence
Jeunes à Droit
Éditorial
Dites-nous ce qu'on a envie d'entendre La recherche universitaire, singulièrement dans le domaine des sciences sociales ou de la justice, est globalement très peu développée ou encouragée en Belgique, en particulier du côté francophone. C’est encore plus vrai en ce qui concerne les enfants, l’aide et la protection de la jeunesse. La récolte de données désagrégées est pratiquement inexistante ou réalisée d’une manière qui ne permet pas de procéder à des évaluations un tant soit peu fondées. Les gouvernements s’appuient peu sur des fondements scientifiques et n’accordent que peu d’attention aux évaluations des politiques et législations. Résultat, les budgets, qui y sont consacrés, sont ridiculement bas. Pourtant, des décrets adoptés ces dernières années prévoient explicitement une obligation d’évaluation. On peut donc espérer que la situation évolue à l’avenir même si l’optimisme n’est pas de mise. Il reste en effet nombre d’obstacles à franchir et notamment le fait que, quand des recherches sont commanditées, le cahier des charges est souvent irréaliste, disproportionné par rapport aux budgets et au temps qu’elles exigeraient. Une recherche sur le Centre communautaire des mineurs dessaisis (recherche CCMD(1)) a dû faire l’objet de trois appels successifs, faute de candidat. À la troisième tentative, avec un cahier des charges un peu réduit, une seule équipe a marqué son intérêt en soumettant une contre-proposition un peu moins irréaliste. Autre écueil trop fréquent : la recherche semble viser à démontrer le bien fondé de politiques, pour leur donner un semblant de légitimité, plutôt qu’à procéder à une évaluation indépendante. Pire, ces recherches réalisées grâce à des moyens publics, une fois finalisées, ne sont pas toujours publiées ni même envoyées au Parlement pour lui permettre de remplir sa mission de contrôler l’exécutif. Serait-ce parce que le commanditaire n’adhère pas aux conclusions ? Le fait que les contrats de recherche contiennent souvent une clause prévoyant l’interdiction de la diffusion de la recherche sans accord du commanditaire est évidemment significatif de l’absence de volonté de transparence. C’est le cas de la recherche CCMD(2). Nous invitons tous les chercheurs à refuser catégoriquement tout contrat de recherche leur faisant interdiction de diffuser la recherche et à céder leur droit de propriété intellectuelle ; nous invitons aussi le monde politique à développer une culture de la recherche et de l’évaluation, de consacrer les budgets et le temps nécessaires, pour que les recherches puissent se réaliser dans de bonnes conditions, de s’engager à rendre systématiquement les recherches publiques et à les diffuser auprès du secteur concerné et du Parlement. Nous nous félicitons de ce que l’AGAJ, dans son plan « L’aide à la jeunesse 2025-2030 : Enjeux et perspectives », recommande de récolter des données, d’évaluer les politiques, de développer des outils analytiques, de participer à l’évaluation des politiques publiques, etc. Il ne reste plus qu’à espérer que ce plan se montre à la hauteur dans sa concrétisation.
Benoit Van Keirsbilck -------------------------------------------------------(1) Voir : www.dei-belgique.be/index.php/projets/acheves/ressaisir-une-recherche-pour-questionner-l-utilisation-du-dessaisissement.html. (2) Le JDJ publiera quoiqu’il en soit les principaux enseignements de cette recherche sous peu.
Ici et ailleurs
Changement de genre... En 2023, 607 personnes (39 de plus qu’en 2022) ont fait adapter la mention M/F sur leur carte d’identité afin de mieux la faire correspondre à leur identité de genre. La moyenne d’âge diminue (une personne sur deux a moins de 25 ans) à la suite du changement de loi de 2017, qui a supprimé toutes les conditions médicales pour faire modifier la mention officielle du genre à l’État civil. (Ref. : Institut pour l’égalité des femmes et des hommes – https://igvm-iefh.belgium.be).
... et enquête nationale Une enquête nationale (la troisième du genre) sur les conditions de vie des personnes transgenres et/ou de genre non binaire est menée par le même institut avec l’Université de Gand pour recenser leurs expériences en matière de discrimination au cours des deux dernières années. Public cible : les 15 ans ou plus qui s’identifient comme une personne transgenre ou de genre non binaire et qui vivent en Belgique. Quelques sujets abordés : l’identité et mode de vie, les documents officiels, les services de soins pour personnes transgenres, le bien-être social, l’expérience de la discrimination, les facteurs de stress et résilience. Enquête ouverte jusqu’en fin juin sur www.tgnbstudy.be
(Notre site internet est actuellement en reconstruction, son accessibilité peut en être affectée)
S'abonner...jeunesseetdroit.be| Contact| Facebook
Vous ne souhaitez plus recevoir nos lettres d'information ? |

